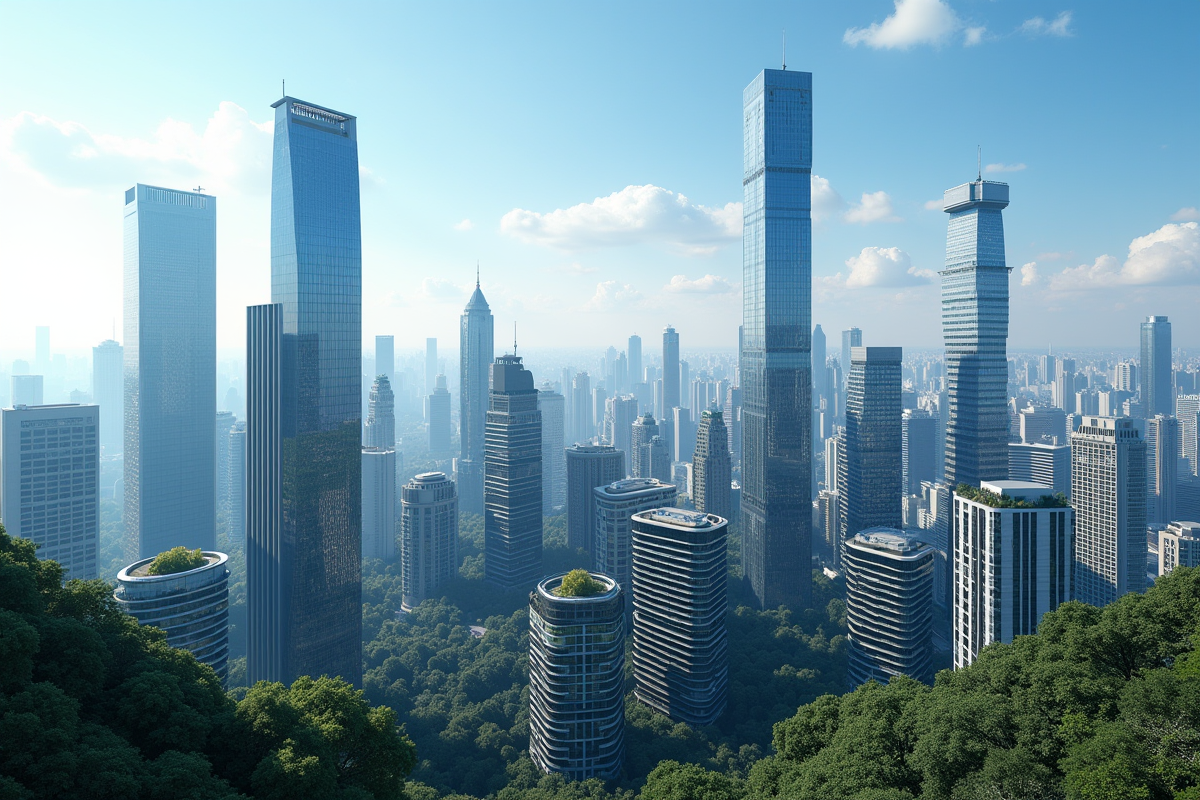177 millions de mètres carrés : c’est ce que possède le Vatican à travers le globe. Un chiffre déjà impressionnant, mais dérisoire face à un mastodonte : la Couronne britannique, qui contrôle près de 6,6 milliards d’hectares, soit plus d’un sixième des terres émergées de la planète. Côté acteurs privés, la famille Irving détient plus de 500 000 hectares au Canada, tandis que l’Américain John Malone accumule presque 900 000 hectares aux États-Unis.
La réalité de cette concentration extrême reste pourtant largement dans l’ombre. États, familles royales, quelques milliardaires : le petit cercle des géants fonciers façonne un monde où l’accès à la terre est tout sauf équitable.
Qui détient vraiment la plus grande part des terres dans le monde ?
La répartition des terres à l’échelle mondiale n’a rien d’anodin. Si l’on s’attarde sur les chiffres, l’inégalité saute aux yeux. Contrairement à l’image populaire de quelques magnats achetant des gratte-ciels, ce sont d’abord les États, les familles royales et certaines institutions religieuses qui règnent sur l’essentiel du foncier mondial. Les volumes en jeu donnent le vertige.
Le Royaume-Uni, par le biais de la Couronne, revendique plus de 6,6 milliards de mètres carrés, soit 660 millions d’hectares : un sixième des terres émergées de la planète. En Russie, l’État détient directement 20 % du territoire national, ce qui représente 400 millions d’hectares. Outre-Atlantique, les terres fédérales américaines s’étendent sur 247 millions d’hectares, principalement dans l’Ouest du pays, un chiffre colossal, souvent méconnu y compris des citoyens américains.
La situation se complexifie côté propriétaires privés. Quelques familles, comme les Irving au Canada ou les Kidman en Australie, accumulent chacune plusieurs centaines de milliers d’hectares. John Malone, entrepreneur américain, approche pour sa part les 900 000 hectares. Les grandes sociétés agricoles et forestières, elles, continuent d’étendre leur emprise, achetant parcelles après parcelles, et renforçant des dynamiques de concentration qui remettent en question la démocratie foncière et la sécurité alimentaire.
Pour illustrer ce paysage inégal, voici quelques exemples marquants de propriétaires fonciers et de leurs empires :
| Propriétaire foncier | Superficie détenue (hectares) |
|---|---|
| Couronne britannique | 660 000 000 |
| État russe | 400 000 000 |
| États-Unis (fédéral) | 247 000 000 |
| John Malone (privé) | 900 000 |
Ainsi, quelques acteurs, qu’ils soient publics ou privés, dessinent les frontières d’un pouvoir discret, rarement discuté sur la place publique, mais dont l’influence façonne le monde.
Panorama des principaux propriétaires fonciers : États, familles et entreprises à l’échelle mondiale
Le partage planétaire des terres s’organise entre un nombre restreint d’acteurs, aux profils très différents. Les États dominent le classement, avec des superficies inégalées. La Couronne britannique, par le biais d’institutions historiques, s’impose avec plus de 6,6 millions de kilomètres carrés répartis sur plusieurs continents. En Russie, l’État orchestre la gestion de 400 millions d’hectares, répartis entre terres agricoles, réserves naturelles et espaces publics.
Mais ce monopole étatique rencontre celui, plus feutré, des familles et grandes fortunes. En Australie, la famille Kidman a longtemps détenu Anna Creek Station, la plus vaste exploitation agricole de la planète : plus de 2,3 millions d’hectares, l’équivalent de la moitié de la Suisse. Au Canada, les Irving règnent sur de vastes forêts, tandis qu’aux États-Unis, John Malone ou Ted Turner possèdent chacun plus de 800 000 hectares, parfois à travers des ranchs, parfois via des investissements forestiers.
Les entreprises ne sont pas en reste. Les grands groupes agroalimentaires et forestiers, notamment, multiplient les acquisitions de terres agricoles en Afrique, en Amérique latine ou en Europe de l’Est. Ce mouvement accélère la concentration des terres et recompose la carte mondiale de la propriété foncière, bien au-delà de la simple opposition public-privé. Ces réseaux imbriqués se construisent au fil de l’histoire, des intérêts stratégiques et des jeux économiques régionaux.
Quels enjeux économiques et sociaux soulève la concentration de la propriété foncière ?
Derrière les chiffres, la concentration foncière transforme la société en profondeur. Lorsqu’un petit nombre d’acteurs, États, grandes familles ou groupes privés, détiennent des millions d’hectares, le partage du territoire devient une question de pouvoir et d’équilibre. Certains propriétaires disposent à eux seuls de plus d’espace que plusieurs pays européens réunis.
Cette mainmise sur les terres limite l’initiative locale. Pour les populations rurales, la raréfaction de l’accès au foncier se traduit par une précarité grandissante, parfois par des déplacements forcés, souvent par une dépendance accrue à des intérêts lointains. Le développement d’immenses domaines privés ou institutionnels entraîne la marchandisation du sol et des ressources, au risque de sacrifier l’intérêt collectif.
Sur le plan économique, la mainmise sur les hectares façonne la chaîne de valeur agricole, influe sur le prix des matières premières et sur la fiscalité locale. Ce contrôle massif favorise la spéculation foncière, avec des conséquences parfois déstabilisatrices pour les marchés et les populations. Les défis ne s’arrêtent pas là : gestion durable des forêts, exploitation minière, préservation de la biodiversité… autant de domaines où la concentration des terres soulève des tensions et des débats.
Dans ce contexte, certains gouvernements tentent de réguler la propriété foncière, tandis que d’autres encouragent l’arrivée d’investisseurs, espérant attirer des capitaux. Partout, la question de l’usage des terres, du partage des ressources et de la souveraineté alimentaire suscite des affrontements entre intérêts privés et exigences collectives. Le partage de la terre, loin d’être un vieux débat, reste l’un des grands enjeux du XXIe siècle.